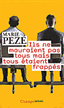La santé des travailleurs, c’est leur boulot. Anne Quélennec est psychologue du travail à Quimper (Finistère). D’après son expérience, être fonctionnaire est loin d’être la planque tranquille qu’on caricature. Stress, épuisement professionnel : ces maux touchent particulièrement les agents de la fonction publique.

Anne Quélennec est psychologue du travail à Quimper (Finistère). Elle fait le point sur la situation du stress et d’épuisement au travail. Entretien.
En tant que psychologue du travail, à quoi êtes-vous confrontée ?
Ça va du stress dans sa définition la plus vaste jusqu’aux salariés exposés à la violence, au harcèlement moral ou sexuel. On distingue le « burn-out », l’épuisement professionnel du « bore-out », quand on s’ennuie dans son travail. Certains sont mis au placard et n’ont vraiment rien à faire. Et on parle désormais aussi de « brown-out », pour les gens qui considèrent que leur boulot ne sert à rien.
Le burn-out n’est pas encore reconnu comme maladie professionnelle ?
Les choses évoluent dans ce sens. Dans le burn-out, on a souvent des gens très impliqués dans leur travail. Parfois la surcharge ne vient pas de l’entreprise mais du salarié lui-même qui ne sait pas s’arrêter, par besoin de reconnaissance, de faire ses preuves, d’être le meilleur…
C’est un phénomène violent ?
Oui ! Une victime de burn-out ne peut plus travailler. En plus des symptômes classiques dont l’épuisement, il y a souvent une forte baisse de l’estime de soi. Un patient me l’avait décrit d’une façon très imagée en me parlant de l’impression d’être un élastique sur lequel on a tiré pendant des mois et qui a lâché d’un coup.
Quelles professions rencontrez-vous le plus ?
Il y a des risques liés à chaque métier. Les aides-soignants en Ehpad [Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes] doivent parfois faire face à l’agressivité de patients malades d’Alzheimer, les pompiers sont éprouvés par les situations qu’ils rencontrent. Il y a des métiers comme les policiers, les infirmiers et les médecins qui sont en souffrance parce que les valeurs sont très engagées.
L’épuisement professionnel n’est pas réservé aux cadres sup’alors ?
Non. C’est vrai qu’en ouvrant mon cabinet, je pensais que j’aurais surtout des cadres en entreprise. Et je me suis aperçue que les agents de la fonction publique souffrent beaucoup. On n’y pense pas forcément mais l’actualité le montre [avec le suicide d’une directrice d’école en région parisienne le 21 septembre].
Qu’est-ce qui peut expliquer ce mal-être dans la fonction publique ?
Il y a cette notion de service public et la volonté de bien faire, confrontées à la réduction de moyens. Et puis dans le privé on peut changer de travail si ça ne convient pas, mais dans la fonction publique ça ne marche pas pareil.
Dans les collectivités locales, les agents vivent au rythme de la vie politique. Avant une élection, les dossiers sont à l’arrêt dans certains services tandis que d’autres comme les services communications sont très sollicités. Et après l’élection, un changement d’équipe municipale peut avoir des conséquences sur l’organisation.
Et du côté de l’école ?
Les enseignants aussi sont touchés, je rencontre parfois des jeunes qui débutent et veulent changer de job au bout de deux ou trois ans. On leur donne souvent des classes multiniveaux en début de carrière. Résultat : ils ont beaucoup de préparation de cours le soir et ils s‘épuisent très vite. Si en plus les rapports avec les familles sont difficiles, ça devient vite différent de ce qu’on imaginait quand on a choisi ce métier…